
Quel est le point commun entre les vampires, Star Wars et Martin Scorsese ? La Hammer, comme va nous le démontrer Nicolas Stanzick, journaliste spécialisé qui vient de sortir un ouvrage sur cette célèbre firme cinématographique.
Bonjour Nicolas, peux-tu te présenter en quelques mots ?
Nicolas Stanzick : Je suis né à Poitiers, en 1978. J’ai grandi là-bas, et ne suis parti qu’à 20 ans pour poursuivre mes études d’histoire à Paris I Panthéon-Sorbonne. Je suis guitariste dans un groupe de rock’n’roll, Ultrazeen, et j’écris à l’Ecran fantastique. Depuis mon plus jeune âge, j’ai toujours eu une passion pour le cinéma, en particulier fantastique. Je crois que tout a commencé lorsque j’ai découvert à l’âge de cinq ans Le Retour du Jedi, en 1983. Une séquence m’avait vraiment fasciné, celle où Darth Vader enlève son masque et révélait son visage d’homme. C’est sans doute là que j’ai été séduit par l’un des fondements du fantastique au cinéma, la figure du double. Toute la cinématographie de Terence Fisher, par exemple, est fondée sur cette notion : Dracula a deux visages, celui de l’aristocrate racé jusqu’au bout des ongles, et celui de la bête fauve entièrement régi par ses pulsions. Bien sûr, je n’ai pas compris cela en des termes aussi intellectualisés à l’époque, c’était un choc esthétique plus qu’autre chose. Par la suite, l’autre évènement fondateur de ma cinéphilie a pris la forme d’une vision manquée. C’était en 1985, Le Cauchemar de Dracula est passé à la Dernière séance, l’émission d’Eddy Mitchell, en deuxième partie de soirée. J’avais vu des photos sur le journal télé, et j’avais absolument envie de voir ça. Evidemment mes parents me l’ont formellement interdit [rires] : c’était trop tard, c’était un film d’horreur, ce n’était pas pour les enfants… Hors de question que je voie ça ! De cette frustration est née ma passion pour les films de vampires. Je voulais tous les voir, et principalement ceux avec Christopher Lee dans le rôle de Dracula. Toutes les semaines, je guettais, dans le journal télé, la diffusion d’un de ces films. Ce qui n’arrivait quasiment jamais, bien sûr : le fantastique, ce n’était pas trop la tasse de thé des chaînes hertziennes de l’époque. J’ai dû attendre jusqu’en 1987 pour voir mon premier Dracula, avec Christopher Lee. C’était Dracula Prince des ténèbres. Si le film avais été mauvais, je l’aurais néanmoins aimé tant j’avais attendu ce moment. Comme il était bon, ce fut une vraie révélation, le vrai déclencheur d’une cinéphilie qui m’a mené à m’intéresser à la Hammer dans son ensemble, mais aussi à l’expressionnisme allemand, l’épouvante hollywoodienne classique, au fantastique moderne, à Lynch, Cronenberg, Carpenter et au cinéma en général.
Nous parlons aujourd’hui de l’ouvrage que tu viens de sortir aux Editions Scali, Dans les Griffes de la Hammer. Comment en es-tu venu à t’intéresser à cette firme cinématographique ?
Il y a deux éléments d’explication : d’une part ce qui s’est passé dans mon enfance, dont je viens de te parler, et d’autre part mon parcours universitaire. J’ai fait des études d’histoire, mais très rapidement, j’ai cherché à travailler sur le cinéma. Par exemple, en UV d’histoire contemporaine, si on avait un travail à faire sur le fascisme, je me débrouillais pour faire un truc sur le cinéma nazi. Quand est arrivée la maîtrise, donc le moment où il me fallait opter pour un sujet de recherche, la Hammer s’est très rapidement imposé. Je voulais travailler sur le fantastique, je connaissais déjà bien ce pan de l’histoire du genre et le cycle Hammer était en tout point un objet idéal pour l’historien : c’est un corpus qui représente 20 ans de cinéma et qui, idéologiquement, économiquement, esthétiquement est extrêmement cohérent. Comment traiter un tel sujet en histoire ? J’ai choisi un angle totalement inédit, celui des gens qui ont aimé ou non – les deux regards m’intéressaient – ce cinéma, qui l’ont découvert en France dans les années 1960. Bref, c’était une manière d’écrire une histoire culturelle du fantastique en France. Cette démarche me semblait prometteuse. Très vite, au bout d’un mois ou deux de recherches, je me suis rendu compte que ce parti pris allait être beaucoup plus payant que je ne l’avais imaginé. Car en France, c’est vraiment avec la vague de la Hammer Films que la cinéphilie du fantastique a débuté, c’est vraiment avec cette nouvelle galerie de monstre en technicolor que le grand public et la critique dans son ensemble s’est initié au genre. Voilà comment je me suis retrouvé à écrire cette histoire française de la Hammer. En réalité, dès la période universitaire, j’avais déjà en tête d’en faire un livre et cette idée me tenait très à cœur. Car au-delà de mon intérêt intellectuel pour le sujet, il y avait aussi quelque chose de très personnel dans ma démarche. Ecrire une histoire française de la Hammer lorsqu’on est soit même cinéphile, amateur de fantastique et amoureux du studio londonien, c’est aussi interroger ses propres passions, son propre parcours. D’où viens-je ? Où vais-je ? Dans quel état j’ère ? [rires]…
Ton livre semble combler un manque au niveau éditorial. As-tu cependant eu des lectures particulières pour le préparer ?
Pour être précis, j’ai passé deux années entières à faire des recherches avant d’écrire la moindre ligne. Ce fut le gros du travail. Je me suis rendu en bibliothèque pour retrouver tout ce qui avait été écrit sur la Hammer à l’époque de sortie des films. Je m’attachais à faire l’histoire de la Hammer en France, il était donc vital pour moi de retrouver les traces de cette histoire. J’ai épluché toutes les revues de cinéma de l’époque de la manière la plus exhaustive possible : Les Cahiers du cinéma, Positif, Cinéma, Ecran, La Revue de cinéma… Mais aussi et surtout Midi-minuit fantastique, la première revue traitant de cinéma fantastique en Europe. A côté de ça, il y avait les livres sortis à l’époque, ceux de Gérard Lenne, Jean-Marie Sabatier, Jean-Pierre Bouyxou. C’étaient des pionniers. Avant l’apparition de la Hammer sur les écrans, il n’y avait absolument rien. Il y avait certes quelques cinéphiles, comme Jean Boulet, qui avaient vu des films Universal dans les années 1930, qui écrivaient à partir de leurs souvenirs dans d’obscures publications, mais c’était tout. Le cinéma fantastique était d’ailleurs considéré au mieux comme infantile, au pire comme « une école de perversion » qui allait créer des « générations de détraqués ». C’est texto ce qu’écrivait l’ancêtre de Télérama, Radio-Cinéma-Télévision, à la sortie du Cauchemar de Dracula en 1959.
Pourquoi avoir intégré une moitié d’interviews dans ton ouvrage, et ne pas en avoir fait un essai classique ?
En fait, les entretiens viennent s’ajouter à ce que tu appelles « l’essai classique » qui occupent les 200 premières pages du livre. Outre les sources de presse que je mentionnais à l’instant, les chiffres du box-office que je suis allé retrouver au CNC, les affiches françaises d’époque et les pavés de presse, j’ai mis un point d’honneur à constituer moi-même de nouvelles sources en recueillant les témoignages des acteurs de cette histoire française de la Hammer : critiques, fondateurs de revue et de festivals, cinéphiles, amateurs de bis… Au-delà de leur très précieuse utilité pour le texte que j’écrivais, je me suis vite rendu compte que tous ces entretiens constituaient quelque chose d’absolument passionnant en tant que tel, de parfaitement complémentaire avec mon texte. La cinéphilie est une passion pleine de contradictions : elle cherche à se constituer en communauté tout en se nourrissant d’émotions intimes qu’elle ne partage finalement pas si facilement. Retranscrire ces témoignages dans leur intégralité, c’était rendre tangible la dimension sensible, humaine, de cette histoire de la Hammer. Mieux : pour une cinéphilie qui se distingue par son gout des mythes, c’était mettre en avant tout une tradition orale qui est aussi le propre de la fantasticophilie. Ecouter Simsolo raconter s’être battu héroïquement à mains nues pour Fisher dans des ciné-clubs récalcitrants, Lemaire délirer sur ses souvenirs du Brady ou Romer fantasmer les incessantes allers et venues des spectateurs du Midi-Minuit comme de fantomatiques apparitions, ce n’est pas autre chose : même si ces anecdotes sont parfaitement fondées, elles finissent par participer d’une véritable mythologie cinéphile dans leur propos.
Tu n’interroges que des intervenants francophones dans ton ouvrage. Est-ce un parti-pris ? Un hasard ? Une obligation ?
C’est un total parti pris. La question sous-jacente de tout l’ouvrage était de comprendre la nature de cette étrange relation qui unit la France et le fantastique. Pourquoi le genre a-t-il été aussi longtemps diabolisé, alors même que c’est ici que fut inventé le cinéma fantastique avec les féeries macabres de Méliès ? Pourquoi l’avènement d’une cinéphilie fantastique n’a-t-il eu lieu que sur le tard, avec la Hammer, alors que des épisodes aussi marquants que le surréalisme, Cocteau, ou les films fantastiques de l’occupation auraient pu jouer un rôle similaire bien plus tôt ? Pourquoi peine-t-on à avoir un genre fantastique domestique ? Exemple symptomatique, en réponse à la Hammer, il y a en Italie tout un mouvement porté par Mario Bava, Riccardo Freda et Antonio Margheretti… Aux Etats-Unis, la réponse ce fut Roger Corman et tout ce qui s’en suivit à l’AIP. Les espagnols ont eu droit à Jess Franco dans les années 1960, Paul Naschy et Armando de Ossorio un peu plus tard… En France, Georges Franju fait avec Les Yeux sans visage en 1960, l’un des plus beaux films fantastiques de tous les temps, un chef d’œuvre absolu : pourtant le film ne lancera strictement aucun mouvement et restera une sorte de prototype de ce qu’aurait pu être le genre ici. Bref, la singularité du rapport français au fantastique, c’est une vraie question.
Et tu as trouvé une réponse à cette question ?
Il y a toujours eu, dans notre pays, cette idée que l’auteur était plus important que le genre. Or on a longtemps pensé que le genre fantastique, précisément, était incapable de fournir des auteurs. Certes dans les années 50, les tenants de la politique des auteurs qui œuvraient dans aux Cahiers du cinéma, Godard, Truffaut and co, ont choisi leurs auteurs favoris dans un cinéma commercial américain a priori impropre à en fournir : c’étaient Ford, Hawks, Hitchcock, Sirk, bref les rois du western, du film noir, du film à suspense ou du mélodrame. C’était une sorte de réflexe de dandy typique de la cinéphilie française et qui consiste en un processus d’intellectualisation du trivial. Les cinéphiles fantastiques n’ont d’ailleurs pas fait autre chose la décennie suivante, lorsqu’ils ont désigné Fisher comme leur emblème avec le numéro Un de la revue Midi-Minuit Fantastique. Mais avant cette date, il y a une telle inculture du genre fantastique en France, que tout le monde considère que ses codes sont trop contraignants pour laisser la moindre sensibilité d’auteur s’exprimer. Ce n’est pas du tout un hasard si les fondateurs de Midi-Minuit Fantastique ont défendu la singularité fisherienne : Michel Caen son plus fervent supporter avait vu les classiques de la Universal, adolescent à la télévision américaine. Il mesurait donc toute l’originalité du cinéaste anglais. Ça a été le début d’une vraie « bataille d’Hernani » autour de cette notion de genre, avec d’un côté la jeune cinéphilie fantastique emmenée par Midi-Minuit Fantastique et de l’autre un large front commun qui condamnait violemment ce « spectacle malsain et dégradant ». Les premiers ont crée une communauté de regard autour de ces films en sublimant la transgression esthétique que constituait le subtil alliage de sexe et de sang propre à la Hammer. Ils défendaient cette vision des choses dans des textes d’une redoutable intelligence subversive, souvent héritée d’une tradition surréaliste érotomane, anti-bourgeoise, athée et anarchisante. Ce n’est vraiment pas un hasard si la production Hammer leur a servi en quelque sorte d’emblème. Ces films prenaient un malin plaisir à mettre en scène des monstres qui mettaient à mal les valeurs de la société victorienne, valeurs qui pour une part étaient toujours d’actualité avant 1968. Dracula, dans Le Cauchemar de Dracula, est un formidable révélateur de la phobie sexuelle victorienne. C’est le monstre qui réalise les fantasmes des jeunes filles esseulées, et en même temps il incarne la toute-puissance érotique à laquelle tout homme rêve de s’identifier, mais que la morale commune se doit de combattre. A la fin du film, Dracula se cache dans la cave de la famille bourgeoise à laquelle il s’attaque, très subtile manière de signifier que le vers est dans le fruit. Le démon fait donc craqueler ce carcan bien-pensant, moral, religieux propre à l’époque. Le monstre est une figure du mal du point de vue bourgeois et se révèle être en contre-partie une entité libératrice, émancipatrice. Mais il est également une figure maléfique à un niveau plus universel, et c’est là toute la richesse dialectique des productions Hammer : le drame de Frankenstein ou Dracula, c’est leur volonté de puissance qui les conduit au meurtre, à l’autodestruction, à la tragédie… Subversifs, audacieux, ces films n’en relevaient pas moins d’une longue tradition populaire. Et d’ailleurs la jeune cinéphilie fantastique française, toute intellectualisée et libertaire qu’elle ait pu être revendiquait très clairement son ancrage dans la culture populaire : celle de la rue, du cinéma de quartier, des boulevards… En face, la presse catholique condamnait tout cela au nom d’une atteinte à la foi : faire de Dracula un héros, hors de question ! Sur ce point Télérama était la revue la plus virulente. Quand on relit ce qu’écrivait Gilbert Salachas, on est frappé de voir à quel point il dit du mal de ces films tout en parlant très bien !... [rires] Certes il les condamne, mais il décode avec une rare maestria la signification érotique des films de Fisher : le puritanisme a toujours eu une compréhension très aigue et donc suspecte de la perversion… La presse communiste elle, accusait le cinéma d’horreur de détourner de l’horreur politique réelle du monde. Et la cinéphilie classique se cachait derrière des alibis intellectuels pour masquer ce qui en fait était une vraie gêne face au genre : d’où la création d’une étonnante catégorisation avec l’émergence de la Hammer, celle des « films infantiles pour adulte »… Bref, c’est avec la Hammer qu’on s’est initié ici, non seulement aux grands mythes que sont Dracula Frankenstein et consorts, mais au genre en tant que tel.
As-tu vu tous les films produits par la firme ?
Non [rires]. Il y en a trop et tous ne sont pas aisément disponibles. J’ai vu en revanche tous leurs films gothiques. Mon livre se concentre sur eux pour une raison évidente : la Hammer est d’abord célèbre pour son cycle gothique, c’est ce qui identifie le studio autant pour les amateurs que pour le grand public. Certes, on ne peut pas réduire non plus la firme à ça. Ils ont produit aussi des films de science-fiction, des films noirs, des films d’aventure, des films de pirates, des productions d’aventures préhistoriques… Pour prendre le cas de Terence Fisher, il a eu une carrière passionnante bien avant Frankenstein s’est échappé. Il a fait des films noirs tout à fait remarquables. Dès 1952, il a réalisé par exemple un film intitulé The Last Page, une histoire de chantage rondement menée. On y trouve notamment une séquence de meurtre qui n’a rien à envier à celle magnifique, de House by the River de Fritz Lang. Il y a encore bien des films méconnus à découvrir au sein de la Hammer.
Le nom de la firme est indéfectiblement lié à ceux de grands noms du genre : Terence Fisher, Bela Lugosi, Christopher Lee, Peter Cushing. C’est aussi, dans les années 1950, la naissance des franchises cinéma, telles que Dracula et Frankenstein. Penses-tu que la firme était en avance sur son temps en termes d’industrie ?
Alors Bela Lugosi pas vraiment. Lorsque la Hammer naît en 1935, l’un des tout premiers films qu’elle produit est un film avec Bela Lugosi : The Mistery of the Marie Celeste. Peut-être était-ce une sorte de signe prémonitoire du penchant pour le fantastique qui allait sceller l’identité de la firme 20 ans plus tard, mais pour autant la collaboration avec Lugosi en est restée à ce film méconnu. Les franchises quant à elles ont toujours existé. La Hammer a eu l’intelligence de reprendre une formule commerciale qui lui préexistait, celle du studio Universal dans les années 1930 avec son bestiaire fantastique développé de films en films, à partir du succès de Dracula et de Frankenstein. Ces séries étaient extrêmement populaires dans les années 1930. Suite au succès retentissant de Frankenstein s’est échappé la Hammer a donc non seulement donné une suite au film, La Revanche de Frankenstein, mais a repris chacun des monstres du bestiaire Universal : Dracula, la momie, le loup-garou, le fantôme de l’opéra, Jekyll/Hyde etc. Au-delà de cette formule commerciale, la Hammer a également repris certains codes du genre initiés de manière spontanée par les géniaux pionniers qu’étaient Tod Browning et James Whale, mais pour le reste, c’était un cinéma d’une radicale nouveauté. La première rupture évidente, c’est évidemment l’usage du Technicolor. Les productions Hammer sont les premières à penser le fantastique en couleurs. Le vrai génie ici c’est Fisher, bien qu’il ne faille pas oublier son admirable chef-opérateur Jack Asher. Par son talent de metteur en scène, sa très grande rigueur dans le traitement des mythes fantastiques, et sa constance d’un film à l’autre, Fisher s’est révélé être véritable créateur de forme. Bien qu’il s’agisse d’abord d’un cinéaste thématique – son évolution vers une totale épure le montre – il est le premier, bien avant Bava, a avoir fait un usage formaliste de la couleur, ce qui lui a permis de développer une esthétique sanglante qui était aussi transgressive pour l’époque que personnelle. Chez lui, le sang est toujours un signe qui renvoie à d’angoissantes questions métaphysiques : il symbolise la pulsion sexuelle chez Dracula, l’idée d’âme au sens philosophique du terme chez Frankenstein. Et néanmoins, ce perpétuel questionnement métaphysique débouche toujours sur l’athéisme : Dracula n’est pas en lutte contre Dieu, mais contre son représentant qui prétend agir en son nom, Van Helsing, et de même l’échec de Frankenstein vient non de dieu mais des limites du monde dans lequel il vit. C’est pour cette raison qu’on a parlé à propos de Fisher de « matérialisme fantastique ». Et lorsque Fisher ne filme pas le sang directement, une tâche rouge se promène systématiquement à l’écran, comme une déflagration qui contraste par sa violence avec les ton pastels ou automnaux qui dominent souvent ses films : c’est tel ou tel effet d’éclairage, un détail de mobilier, un rideau, un tableau, comme le signe d’une pulsion qui sommeille en tout homme et qui contamine nécessairement son point de vue sur le monde. Ce n’est pas pour rien que la critique bien pensante à parlé « d’obscénité de la couleur » chez Fisher. Et l’on touche ici à la deuxième grande rupture vis-à-vis du cycle Universal : les films de la Hammer étaient aussi des films érotiques. Non pas parce qu’on pouvait y voir la moindre nudité (ça n’a jamais été le cas à l’exception de quelques Hammer tardifs des années 70), mais parce que la sexualité était bien souvent le vrai sujet de ces films. Prenons Dracula : certes la composante sexuelle est présente dès Murnau, dès Browning, mais chez Fisher elle n’est plus à la périphérie, elle est le sujet même du film. Pour faire court, La Cauchemar de Dracula, c’est ni plus ni moins qu’un appel à l’orgasme, à une sexualité libre, folle, qui fait fi de toutes les conventions sociales, morales ou culturelles, et Van Helsing combat très clairement le comte vampire en se vivant comme un gardien de l’ordre moral. Ce qui m’amène à la troisième rupture vis-à-vis du cycle Universal : toutes les productions Hammer avaient pour cadre une société et une période historique très précises, l’ère victorienne, tandis que chez la Universal, tout se passait dans une Transylvanie d’opérette à une époque non identifiée. La Hammer a participé d’autre part, avec quelques années d’avance sur les Beatles et les Rolling Stones à l’émergence de la Révolution pop et de la contre-culture. Bref, si l’on reprend l’histoire du cinéma fantastique, il y a d’abord eu l’âge d’or allemand des années 20 qui offrait une sorte de représentation de l’inconscient collectif, puis l’ère américaine de la Universal durant les années 30 qui s’assumait comme la représentation poétique et déréalisée d’un imaginaire fantastique, puis la génération Tourneur, Wise, Robson sous l’égide de Val Lewton qui créa un cinéma de l’indicible et de l’invisible dans la décennie suivante. Avec la Hammer à la fin des années 50, pour la première fois nous avons droit à des monstres de chair et de sang qui évoluent comme autant de forces symboliques dans un monde bien réel : le nôtre.
Suite dans une prochaine note.



/http%3A%2F%2Fwww.noosfere.org%2Fimages%2Fcouv%2FG%2FGarancAF03.jpg)
/http%3A%2F%2Fifisdead.net%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F06%2FLes-Lames-du-Cardinal-Integrale-de-Pierre-Pevel.jpg)

/http%3A%2F%2Fextranet.editis.com%2Fit-yonixweb%2FIMAGES%2FPOC%2FP3%2F9782266166041.JPG)

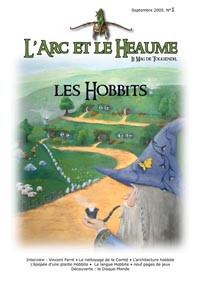
/http%3A%2F%2Fwww.lekti-ecriture.com%2Fblogs%2Falamblog%2Fpublic%2FGancheMortLivre.jpg)
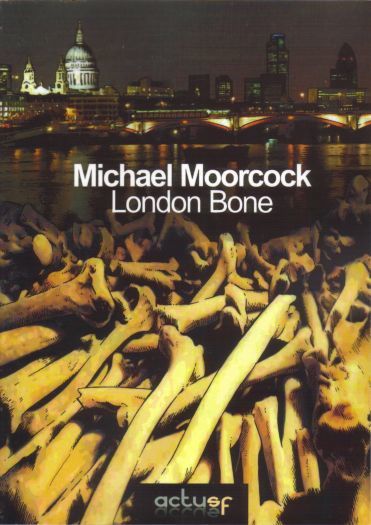
/http%3A%2F%2Fdi1-4.shoppingshadow.com%2Fimages%2Fpi%2F2f%2F91%2Fa0%2F2040045844-260x260-0-0_Glace_De_Feu_2040045844.jpg)

/http%3A%2F%2Fwww.eclipse.fr%2Fimages%2Fstories%2Fcouvertures%2Fhorreur%2Fvictoria.jpg)
/http%3A%2F%2Feditions.librairie-critic.fr%2Fmedia%2Fcatalog%2Fproduct%2Fcache%2F3%2Fimage%2F500x500%2F9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95%2F9%2F7%2F9791090648104.)


/http%3A%2F%2Fa69.g.akamai.net%2Fn%2F69%2F10688%2Fv1%2Fimg5.allocine.fr%2Facmedia%2Frsz%2F434%2Fx%2Fx%2Fx%2Fmedias%2Fnmedia%2F18%2F35%2F16%2F34%2F18365833.jpg)
/http%3A%2F%2Fa69.g.akamai.net%2Fn%2F69%2F10688%2Fv1%2Fimg5.allocine.fr%2Facmedia%2Frsz%2F434%2Fx%2Fx%2Fx%2Fmedias%2Fnmedia%2F18%2F35%2F16%2F34%2F18365835.jpg)
/http%3A%2F%2Fa69.g.akamai.net%2Fn%2F69%2F10688%2Fv1%2Fimg5.allocine.fr%2Facmedia%2Frsz%2F434%2Fx%2Fx%2Fx%2Fmedias%2Fnmedia%2F18%2F35%2F16%2F34%2F18892911.jpg)

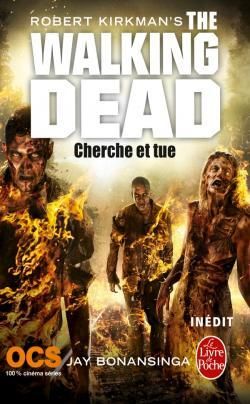
/image%2F1014460%2F20240410%2Fob_0568de_9782226481474-j.jpg%3Fitok%3DOcvnKcTJ)
/image%2F1014460%2F20240402%2Fob_d074e3_9782253937012-001-t.jpeg%3Fitok%3DGFvSaCRV)
/image%2F1014460%2F20240328%2Fob_3398d5_8adca156c274816e9d0b9c2570577a033fe638.jpg)
/image%2F1014460%2F20240304%2Fob_475fa9_5168199.jpg)
/image%2F1014460%2F20240223%2Fob_3b2950_m02841726371-large.jpg)
/image%2F1014460%2F20240216%2Fob_094bcc_3764699.jpg)