/http%3A%2F%2Fa69.g.akamai.net%2Fn%2F69%2F10688%2Fv1%2Fimg5.allocine.fr%2Facmedia%2Frsz%2F434%2Fx%2Fx%2Fx%2Fmedias%2Fnmedia%2F18%2F35%2F14%2F60%2F18363837.jpg)
Ode à la Bête
Sèchement mise en demeure, hier soir, d’expliquer une bonne fois pour toutes ce qui me faisait affirmer qu’Alien était un chef-d’œuvre, je me suis entendue bafouiller en réponse un assez pitoyable : « mais enfin, c’est évident ». Ce qui, somme toute, ne constituait ni une justification ni même le début du commencement d’une tentative d’explication, mais bel et bien une manière de clore la discussion. Avec, en plus, le sentiment toujours détestable pour autrui, d’avoir raison.
Seulement, voilà, il se trouve que je pense bel et bien qu’Alien est un chef-d’œuvre, et que je ne suis pas la seule à lui accorder ce statut. Lorsque l’on me demande pourquoi, c’est en général dans le but de souligner à quel point il est (ou serait) malsain d’éprouver une telle fascination pour un film aussi évidemment monstrueux. Hors tout jugement moral, cependant, je me dois de rappeler quelques qualités propres à ce film de 1979, ne serait-ce que pour donner une tonalité plus objective à mon opinion le concernant.
Alien, c’est l’histoire de 7 personnages (plus un chat !) pris au piège dans un vaisseau spatial avec une grosse bêbête tout à fait hostile et tout à fait autre (d’où d’ailleurs le titre français : Alien, le 8ème passager). Une sorte de Dix petits nègres à la sauce spatiale, si l’on veut, avec cet avantage que, comme le proclame à l’époque le slogan du film, dans l’espace, personne ne vous entend crier. Autrement dit : accrochez vos ceintures, ceci est un huis-clos dans les étoiles. Il y aura donc des morts (mais qui ?), des hors-champs (où est l’alien ?), des crises de nerfs (à la fois dans la salle et sur le plateau, d’ailleurs) et des affrontements.
Voilà donc comment l’on peut résumer l’intrigue du film qui a constitué une véritable date dans l’histoire de la science-fiction à l’écran. Mais une fois qu’on a dit ça, on n’a rien dit. Car pour mémoire, Alien sort aux Etats-Unis deux ans après la Guerre des étoiles, autrement dit en pleine vogue du « space opera ». Et face à l’univers fantaisiste et coloré qu’a popularisé (ô combien !) le film de G. Lucas, Alien se présente délibérément comme la peinture réaliste, voire pessimiste, d’un futur crédible auquel nous pouvons adhérer sans trop de peine. En gros, ce que nous montre Ridley Scott, c’est l’envers du décor. L’envers du rêve. Et ceci nous amène directement au cauchemar proprement dit : l’alien.
Le film débute très lentement, ce qui est aujourd’hui sans doute encore plus qu’hier une de ses plus belles qualités stylistiques. Ridley Scott prend le temps de nous promener au sein du milieu clos qui va constituer le principal décor de l’action. Commençant par une vue extérieure du vaisseau spatial lui-même (le bien-nommé Nostromo, en hommage à Conrad, je suppose), sorte d’immense usine de raffinage à peu près aussi exotique qu’une plate-forme pétrolière, il nous en fait ensuite parcourir par caméra interposée les coursives vides, mal entretenues et peu engageantes. Nous passons de la salle des machines au secteur supérieur, poste de commandes et quartiers de l’équipage, avant d’atteindre enfin la salle où les sept « héros » de notre histoire sont plongés dans le sommeil pendant que le vaisseau fonce vers la Terre selon une trajectoire préprogrammée. Cette balade introductive a posé en, disons, 5 minutes, la totalité de l’univers dans lequel s’inscrit Alien. C’est-à-dire une monde à la fois futuriste et familier, où les machines tiennent une place très importante et où, pourtant les différences de classes sont toujours bien présentes, hiérarchisant les relations professionnelles. Car de la même manière que R. Scott nous a tranquillement emmenés des soutes du Nostromo aux quartiers plus pimpants de commandement, la lente scène d’exposition des personnages (leur réveil par l’ordinateur de bord surnommé Maman, le déjeuner commun, la reprise de fonction…) laissera éclater immédiatement le conflit latent entre les mécaniciens et les cols blancs que sont les officiers de navigation. C’est l’une des choses qui rendent ce futur si réaliste. Il est crédible, il fonctionne sur des normes sociales que nous pouvons comprendre, et finalement, ces 7 personnages que nous apprenons à peine à connaître ont beau piloter un engin spatial, ce ne sont jamais que de simples routiers, employés d’une compagnie monolithique. Bref, c’est vous et moi. On est très loin de l’héroïsme épique de la science-fiction illustrée par La guerre des étoiles. Ridley Scott poursuivra d’ailleurs cette veine de l’anticipation réaliste avec Blade Runner, quelques années plus tard.
Nous sommes donc dans un monde où les personnages n’ont pas le choix : ils font le travail pour lequel ils sont payés. Et lorsque leur ordinateur de bord détecte un message de détresse en provenance d’une planète inconnue, hé bien, l’équipage applique à la lettre les règles de la Compagnie. Comme le dit le capitaine Dallas, c’est comme ça et puis c’est tout. Nos héros, qui ne sont justement pas des héros mais des gens ordinaires, vont essayer au mieux de répondre à cet appel de détresse. Sous les ordres de Dallas, le second Kane, les navigatrices Lambert et Ripley et l’officier scientifique Ash prennent les commandes en passerelle. Les deux derniers membres de l’équipage, Brett et Parker, gagnent la salle des machines. L’atterrissage ne se passe pas très bien, premier ennui ; deuxième ennui, les 3 membres d’équipage (Dallas, Kane et Lambert) envoyés en exploration pendant que les autres réparent le Nostromo, tombent sur un vaisseau de toute évidence échoué et de toute évidence totalement étranger. C’est la première scène choc du film, la découverte du vaisseau et de sa cargaison. Le temps que tout le monde réalise qu’y pénétrer était une mauvaise idée, le second du Nostromo, Kane, se retrouve avec un parasite accroché au visage. Et je défie quiconque voit ce moment pour la première fois de ne pas sursauter. Alien commence véritablement quand, voulant sauver Kane, ses compagnons le ramènent au Nostromo. Ce faisant, ils introduisent la Bête immonde (c’est vraiment le mot !) dans leur univers si familier et si paisible. Et nous avons à cet instant du film le premier indice (ténu) de qui est le héros de l’histoire, celui auquel le spectateur pourra s’identifier sans risquer de le voir mourir.
Mais nous avons aussi droit à notre deuxième scène choc, celle qui a fait la réputation du film, et aussi celle qui permet ensuite à Ridley Scott de ne plus monter l’horreur autrement que par suggestion. Il s’agit bien sûr de l’éventration interne de Kane par la chose que le parasite a pondu dans sa poitrine. Voilà. C’est une scène terrifiante de bout en bout, la pire que j’ai jamais vue, qui a traumatisé les acteurs au même titre que les spectateurs. Je ne la décrirai pas, parce que je ne pense pas que cela constitue vraiment le meilleur du film. Ce que je trouve particulièrement réussi, par contre, c’est l’état de sidération totale qui frappe les survivants à l’issu de cette scène cauchemardesque. Nous avons peut-être 20 secondes figées qui concluent la mort de Kane, et il m’a toujours semblé que ces 20 secondes s’adressaient directement aux spectateurs. Faisaient que spectateurs et personnages traversaient exactement la même chose. Là encore, le style de Ridley Scott frappe comme un uppercut avec une totale économie de moyens.
A présent, chacun sait que la Bête est là. C’est le troisième chapitre du film, la traque improvisée du monstre qui a tué l’un des leurs. Ce chapitre se conclue par la mort de deux membres supplémentaires d’équipage, dont le capitaine Dallas lui-même, et par la révélation de la trahison d’un troisième. Alien élimine donc à peu près à la moitié du film le personnage que l’on prenait pour le héros. Nous voici pris au dépourvu, incapables désormais de prévoir qui survivra ou non, incapables en fait de savoir si quelqu’un survivra.
La quatrième partie du film pourrait être intitulée : « Fuyons, fuyons ! » ou, comme l’ont fait la plupart des commentateurs, « la Belle et la Bête ». Car Alien se clôt sur un duel épique entre Ripley et le monstre, duel qui la hisse, elle au rang d’héroïne, et qui fait de lui, le réceptacle parfait de toutes les analyses érotico-perverses que l’on voudra bien inventer. Nous quittons alors le monde futuriste que Ridley Scott avait si bien illustré jusque-là. Et nous entrons dans celui du conte, ou de la légende, ou du symbole. Nous entrons dans celui de l’alien proprement dit.
/http%3A%2F%2Fa69.g.akamai.net%2Fn%2F69%2F10688%2Fv1%2Fimg5.allocine.fr%2Facmedia%2Frsz%2F434%2Fx%2Fx%2Fx%2Fmedias%2Fnmedia%2F18%2F35%2F14%2F60%2F18892810.jpg)
Et c’est bel et bien grâce à son monstre qu'Alien peut prétendre, me semble-t-il, au titre de chef-d’œuvre du genre fantastique. Car en dehors de ses qualités cinématographiques réelles, de sa construction parfaite et de son art du hors-champ, le film a surtout permis l’éclosion à l’écran de la première créature totalement originale mise en scène par ce médium. En d’autres termes, l’Alien de Ridley Scott apparaît conçu par et pour le cinéma, sans background référentiel, sui generis pourrait-on dire. Un seul film suffit à lui donner non seulement une apparence (encore que cette apparence reste très largement dans l’ombre, contrairement au souvenir que nous en avons), mais aussi toute une histoire, ce qui nous permet de le croire réel. A mes yeux, Alien n’est peut-être pas tout à fait le film de terreur que son synopsis nous vend. Bien plus intéressante est la manière dont est construite l’intrigue, et cette intrigue est le récit de l’enfantement du monstre. De l’œuf à l’âge adulte, littéralement. Le développement de l’alien passe par différents stades bien marqués, qui sont les seuls ressorts de l’action en huis-clos. Tout tourne autour de la prochaine forme qu’il prendra, alors même que jamais nous ne voyons vraiment à l’écran celle qu’il a au moment où les humains l’affrontent. Il est définitivement autre, définitivement terrifiant. Et il est magnifique dans son accomplissement.
L’alien a été créé par l’artiste suisse H. R. Giger, dont l’une des spécificités est le mélange du mécanique et du biologique, les deux si intiment entrecroisés que le malaise du spectateur ne peut plus s’appuyer sur rien de vraiment perceptible. Indéniablement, ce que nous montre Giger est différent, mais sa fascination pour le squelette, les os et autres structures aisément reconnaissables nous empêche de nier une parenté avec les créatures représentées. Son alien est à la fois extraordinairement physique, issu de notre propre chair, et tissé de caractéristiques insectoïdes qui nous font pénétrer au cœur de nos plus profonds cauchemars, ceux où l’intégrité physique humaine volerait en éclats. Il est donc, viscéralement, question de corps, de pénétration, de violation et de transformation dans la manière dont H.R. Giger représente l’étranger absolu qu’est l’alien. Matière en constante modification, créature intelligente qui semble vouloir un peu plus que la simple destruction de l’adversaire, qui semble en fait vouloir son assimilation totale, l’alien est la matérialisation de peurs ancestrales qui font de lui l’idéale monstruosité. Et qui lui donnent, je pèse mes mots, sa beauté inattendue. En tant qu’autre, en tant qu’étranger, l’alien symbolise bien le pire de nos craintes, car il est d’abord celui qui abolit toute notion de frontière, et il le fait par le biais du corps.
C’est donc cette créature qui fait d’Alien, le 8ème passager, quelque chose d’entièrement nouveau au cinéma. Et le plus fascinant est sans doute que la généalogie de ce monstre d’exception, sans équivalent dans le 7ème art, sera ensuite déclinée avec une parfaite cohérence par trois réalisateurs aussi différents que James Cameron (Aliens), David Fincher (Alien3) et Jean-Pierre Jeunet (Alien : Resurrection). Nous y apprendrons l’origine des œufs, nous y apprendrons aussi que la forme adulte de l’alien est étroitement liée à celle de son hôte et que s’il semble humanoïde, c’est grâce à nous (brr…), et nous découvrirons toute l’étendue de son intelligence perverse. Le dernier film (à ce stade) boucle la boucle en accordant à l’alien des caractéristiques humaines tout en faisant de Ripley, seule véritable survivante de la confrontation sans cesse renouvelée, un hybride tenant tout autant du monstre que de l’héroïne. Il faudrait, pour être complet, aborder aussi la place très importante tenue par les androïdes dans la quadrilogie, ainsi que la critique sociale inattendue dans ce genre de films et présente sous une forme ou une autre dans chaque volet. Mais ce serait m’éloigner de mon propos, qui était avant tout de souligner l’unicité d’Alien en tant que générateur d’un mythe purement cinématographique.
Bérengère.




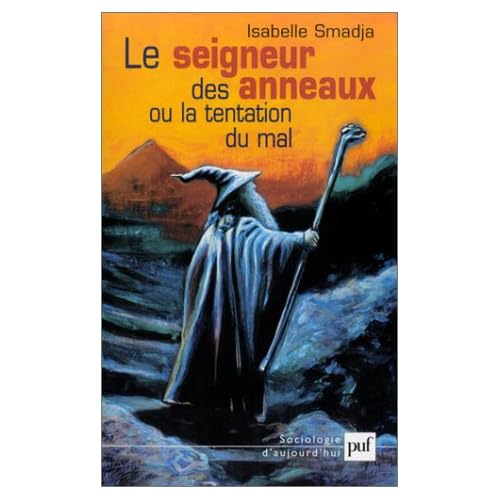
/http%3A%2F%2Ftk.files.storage.msn.com%2Fx1pbglk-vqL4Bv7qRBD0XggfKMkEtSulXWzjDIrPTKIlRWZN_zC77bCI2jrpbfRyUou6qc-9ajPAGNJxCYQxLsYGmJhKojFL1DlY_khpF6-pqtq-siOu8wK5VvbjuQea7WhdbXlEnTalBxZndSgN5DY_khsjrajTJqx)
/http%3A%2F%2Fimg-fan.theonering.net%2Frolozo%2Fimages%2Fedelfeldt%2Fgollum.jpg)
/http%3A%2F%2Fa69.g.akamai.net%2Fn%2F69%2F10688%2Fv1%2Fimg5.allocine.fr%2Facmedia%2Frsz%2F434%2Fx%2Fx%2Fx%2Fmedias%2Fnmedia%2F18%2F35%2F14%2F60%2F18363837.jpg)
/http%3A%2F%2Fa69.g.akamai.net%2Fn%2F69%2F10688%2Fv1%2Fimg5.allocine.fr%2Facmedia%2Frsz%2F434%2Fx%2Fx%2Fx%2Fmedias%2Fnmedia%2F18%2F35%2F14%2F60%2F18892810.jpg)


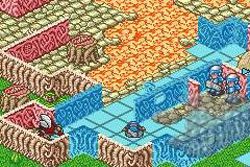


/http%3A%2F%2Fpourtolkien.free.fr%2Fpics%2Fmonstres%20grand.jpg)
/http%3A%2F%2Flefantasio.com%2Fimages%2Flectures%2Fblaze1.jpg)
/image%2F1014460%2F20240410%2Fob_0568de_9782226481474-j.jpg%3Fitok%3DOcvnKcTJ)
/image%2F1014460%2F20240402%2Fob_d074e3_9782253937012-001-t.jpeg%3Fitok%3DGFvSaCRV)
/image%2F1014460%2F20240328%2Fob_3398d5_8adca156c274816e9d0b9c2570577a033fe638.jpg)
/image%2F1014460%2F20240304%2Fob_475fa9_5168199.jpg)
/image%2F1014460%2F20240223%2Fob_3b2950_m02841726371-large.jpg)
/image%2F1014460%2F20240216%2Fob_094bcc_3764699.jpg)